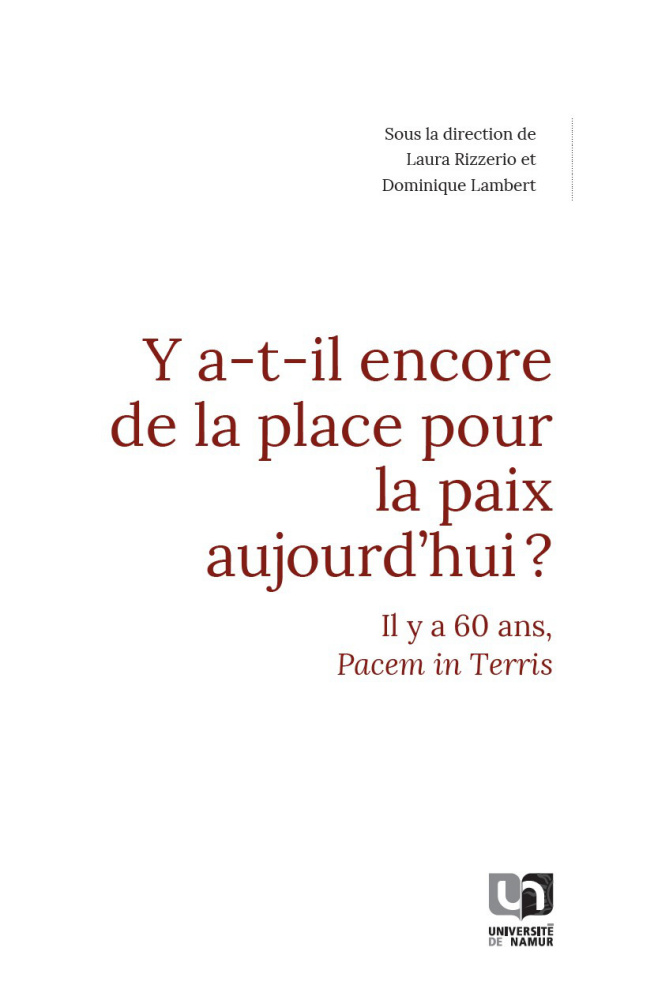Y a-t-il encore de la place pour la paix aujourd'hui ?
Il y a 60 ans, Pacem in Terris
Première édition
Dans un monde marqué par les conflits, cet ouvrage explore la paix comme un projet actif : solidarité, dialogue et respect des droits. Fruit d'une journée d'étude, il revisite "Pacem in Terris" et interroge les chemins vers une société fondée sur le bien commun. Lire la suite
Traiter de la paix aujourd'hui peut sembler saugrenu tant il y a de guerres qui éclatent à nos portes et de voix qui se lèvent pour justifier un réarmement généralisé de l'Europe. Et pourtant, certaines voix, certes peu médiatisées, continuent d'implorer la paix auprès des dirigeants de ce monde. Une paix qui se veut non seulement comme une absence de guerre, mais aussi et surtout comme le résultat d'actions de solidarité, de dialogue et de respect des droits fondamentaux des personnes, permettant l'édification d'une société où l’accueil des différences, la coopération entre tous les vivants, humains et non-humains, et la recherche du bien commun seraient considérés comme prioritaires par rapport à la sauvegarde
des intérêts particuliers.
Parmi ces voix, il y a aussi celle de l’Église, qui a prêché la paix tout au long de son histoire comme la naturelle application du message de l’Évangile. Ce fut le cas, par exemple, lors de la dramatique crise des missiles de Cuba en octobre 1962, qui a failli déclencher une guerre nucléaire dévastatrice. Cette crise a été stoppée de justesse grâce, entre autres, à l’intervention directe du pape Jean XXIII. Quelques mois plus tard, le 11 avril 1963, paraissait son encyclique Pacem in Terris, dans laquelle il proposait un plaidoyer pour la paix qui devint finalement son testament spirituel.
Cet ouvrage constitue le résultat d’une réflexion menée lors d’une journée d’études consacrée à l’enseignement de Pacem in Terris à l’occasion des 60 ans de sa publication et, plus largement, à la position de l’Église catholique à propos de la paix en ces temps agités par de nombreux conflits.
Spécifications
- Éditeur
- Presses universitaires de Namur
- Contributions de
- Thomas Antoine, Bruno Colson, Jean De Volder, Cécile Dubernet, Dominique Lambert, Christian Mellon,
- Édité par
- Laura Rizzerio,
- Collection
- Philosophies, Religions & Sociétés | n° 6
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Classification thématique - Presses universitaires Namur > Philosophie
- BISAC Subject Heading
- PHI000000 PHILOSOPHY > PHI022000 PHILOSOPHY / Religious > PHI034000 PHILOSOPHY / Social
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur > 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3364 Religion et société > 3126 Philosophie
- Date de première publication du titre
- 02 décembre 2025
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Recherche sur la paix et la résolution de conflits
Classification thématique Thema: Philosophie et religion
Classification thématique Thema: Christianisme romain, Eglise catholique romaine
Livre broché
- Date de publication
- 02 décembre 2025
- ISBN-13
- 978-2-39029-228-9
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 105
- Code interne
- 9782390292289
- Prix
- 13,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3